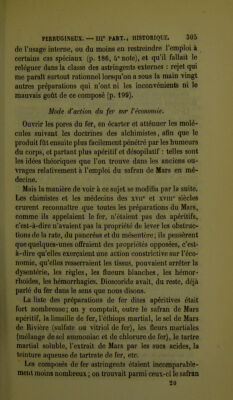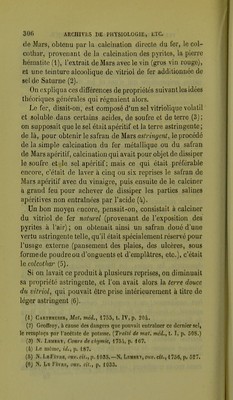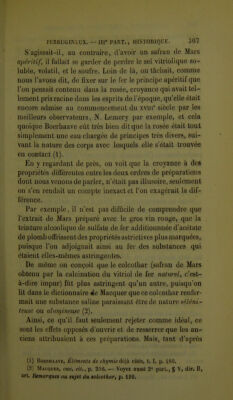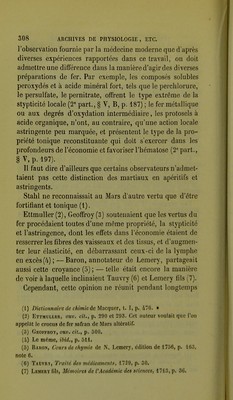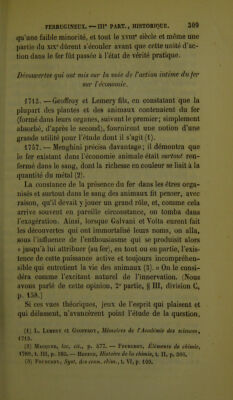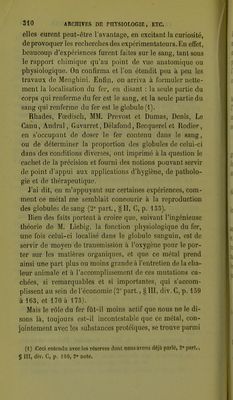Mémoire sur l'action physiologique et thérapeutique des ferrugineux / par T.-A. Quevenne.
- Quevenne, Théodore Auguste, 1805-1855.
- Date:
- 1854
Licence: Public Domain Mark
Credit: Mémoire sur l'action physiologique et thérapeutique des ferrugineux / par T.-A. Quevenne. Source: Wellcome Collection.
Provider: This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England.
302/353 (page 306)
![de Mars, obtenu par la calc'mation directe du fer, le col- cothar, provenant de la calcination des pyrites, la pierre hématite (1), l'extrait de Mars avec le vin (gros vin rouge), et une teinture alcoolique de vitriol de fer additionnée de sel de Saturne (2). On expliqua ces différences de propriétés suivant les idées théoriques générales qui régnaient alors. Le fer, disait-on, est composé d'un sel vitriolique volatil et soluble dans certains acides, de soufre et de terre (3); on supposait que le sel était apéritif et la terre astringente ; de là, pour obtenir le safran de Mars astringent, le procédé de la simple calcination du fer métallique ou du safran de Mars apéritif, calcination qui avait pour objet de dissiper le soufre et le sel apéritif ; mais ce qui était préférable encore, c'était de laver à cinq ou six reprises le safran de Mars apéritif avec du vinaigre, puis ensuite de le calciner à grand feu pour achever de dissiper les parties salines apéritives non entraînées par l'acide {h). Un bon moyçn encore, pensait-on, consistait à calciner du vitriol de fer naturel (provenant de l'exposition des pyrites à l'air) ; on obtenait ainsi un safran doué d'une vertu astringente telle, qu'il était spécialement réservé pour l'usage externe (pansement des plaies, des ulcères, sous forme de poudre ou d'onguents et d'emplâtres, etc.), c'était le colcothar (5). Si on lavait ce produit à plusieurs reprises, on diminuait sa propriété astringente, et l'on avait alors la terre douce du vitriol, qui pouvait être prise intérieurement à titre de léger astringent (6). (1) CAnTHEUSEn, Mat. mcd., 1755, t. IV, p. 204. (2) Geoffroy, à cause des dangers que pouvait entraîner ce dernier selj le remplaça par l'acétate de potasse. {Traité de mat, mcd., t. I, p. 508.) (0) N. LuMBny, Courx dechymic, 175i, p. 167. [Il] Le même, id,, p. 187. (6) N. LaFiivnB, otti'. cîf.,p. 1033.—N, Lf-mbiiy, ohv. 1756, p. 527.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b22268996_0306.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)